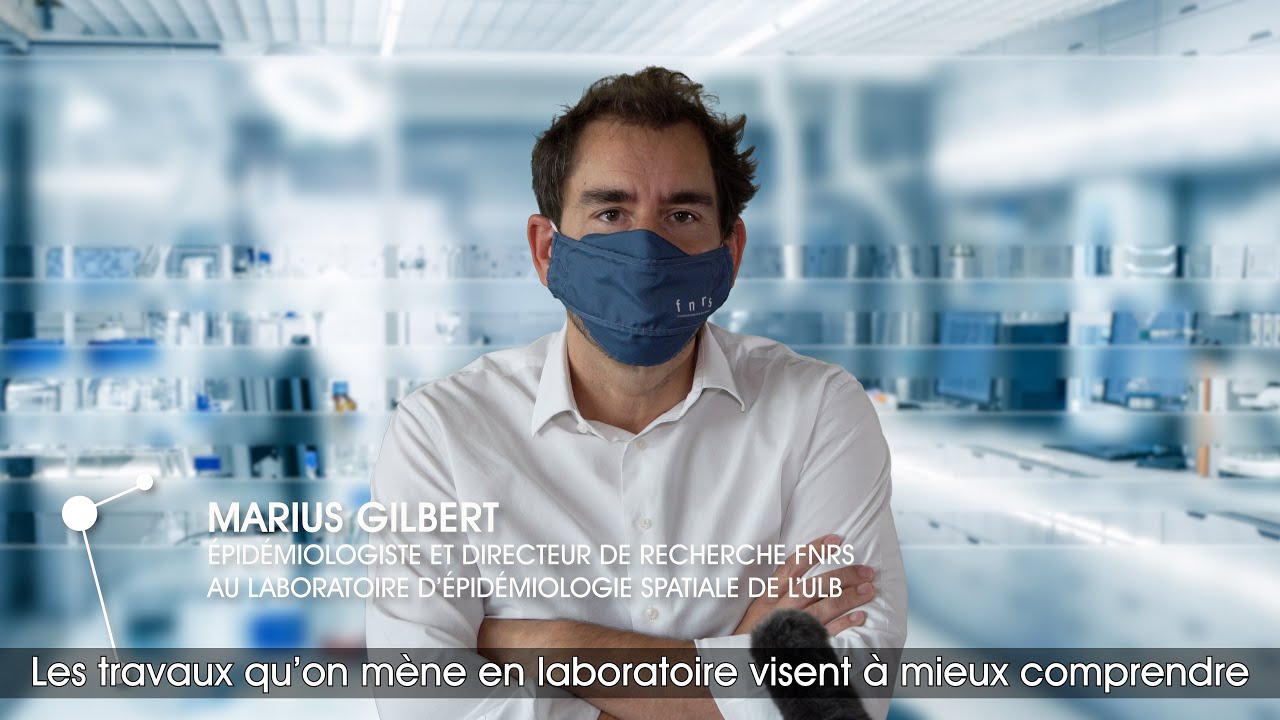
07 janvier 2021
MARIUS GILBERT : DES PETITES BÊTES AU GRAND MECHANT LOUP (interview)
L’interview de l’Asympto : Marius Gilbert.
La première fois que j’ai vu sa tête à la télé, je me suis dis : « Tiens, je connais cette tête-là ».
Marius Gilbert est un des experts qui nous ont accompagné pendant tout le premier confinement, quand on applaudissait tous les soirs à 20 heures les infirmières et les soignants.
Vous vous rappelez ?
Avec sa barbe de 48 heures d’homme occupé, il nous prenait par la main pour nous raconter, avec pédagogie, empathie et clarté, les mystérieuses aventures du coronavirus.
A l’époque, il partageait encore son sourire.
Cet automne, il parle masqué.
Mais pas aujourd’hui.
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous sur Zoom à 18 heures pour une « vidéo-interview », et c’est lui qui commence à poser les questions.
Marius : Alors… Comment ça se passe, ce confinement ?
Claude : …Plutôt bien pour moi.
Parce que je le vis en famille, avec mon fils, ma compagne, et mon filleul le week-end. J’ai ma dose d’amour et de travail.
Mais comme tu le sais, la culture est, avec l’Horeca, le secteur qui a le plus morflé. Tout a été annulé.
Alors, avec l’Asymptomatique, je me suis fabriqué une petite fenêtre sur l’extérieur…
Marius : C’est un beau projet. Je n’ai pas relu tes questions, parce que je préfère garder la spontanéité d’une « vraie » conversation…
Claude : Je comprends ça. De toutes façons, je te ferai relire l’interview avant publication pour éviter les malentendus.
Bon, commençons peut-être par la petite histoire. La Belgique est décidément un petit pays.
Tu es le fils de Michel Gilbert, alias « Roudoudou »,… le chanteur du GAM (Groupe d’Action Musical), et tu as donc grandi entre les chansons et les luttes sociales.
La dernière fois qu’on s’est croisé, tu devais avoir dix ans, à Goutroux ou dans une manif. Ca m’a fait drôle de t’avoir retrouvé au début de l’année au JT, repeint en spécialiste du corona. Qu’est-ce qui, dans tes études, t’a conduit à l’épidémiologie ?

Michel Gilbert, alias Roudoudou, avec le GAM. De dos, Jacqueline au violon face à Karine à l’alto Photo Véronique Vercheval
Marius : Ha ! Tu as oublié la fois où tu m’as donné des cours de chanson française à Libramont… ! Mais pour en revenir aux études, j’ai toujours été attiré par les sciences exactes, le côté casse-tête, essayer de comprendre et dénouer les choses…
Claude (éclatant de rire) : Tu ne vas pas me dire que l’épidémiologie est une science exacte ? Ce qui se passe pour le moment ne semble pas le prouver, en tous cas…
Marius (souriant) : On peut en rediscuter… Mais si, c’est une science exacte, mais à plusieurs variables qui ne cessent de changer.
En science expérimentale, on peut faire varier un facteur à la fois.
Mais une société, c’est un ensemble de facteurs qui réagissent en permanence et simultanément les uns aux côtés des autres.
C’est donc très difficile d’isoler l’effet d’un facteur à la fois, par exemple l’effet d’une mesure particulière sur la contamination.
Mais je reviens à ta question. J’avais une vraie attirance pour les choses du vivant, et je me suis orienté vers la bio-ingénierie, enfin, à l’époque, cela s’appelait « ingénieur agronome ».
J’aimais bien aussi le côté « terroir » de ces études.
Et donc, j’ai fait l’agro à l’ULB, et puis une thèse de doctorat sur les insectes ravageurs. Toujours avec des approches statistiques.
Et ça m’a amené, à un moment de ma carrière, vers l’épidémiologie animale, puis vers les « zoonoses », ces maladies qui se transmettent de l’animal à l’homme.
J’ai ainsi beaucoup travaillé sur la grippe aviaire, et par ce biais-là, j’ai commencé à collaborer avec les scientifiques chinois.
Et donc, quand une nouvelle zoonose a surgi dans le sud-est de la Chine, le coronavirus, je me suis immédiatement intéressé à la chose. Voilà mon parcours, très très résumé.
Mais ce que le grand public ne le sait pas, c’est que l’épidémiologie, ce n’est pas la virologie.
Pour les gens qui travaillent en épidémiologie humaine, il y a toujours des éléments incontrôlables, qui font intervenir le libre-arbitre des personnes, et on est tout le temps obligé de composer avec l’imprévisibilité de l’humain.
Parfois, les modèles mathématiques prévoient une chose, et il s’en passe une autre.
C’est une difficulté intrinsèque à cette discipline là.
Claude : C’est donc par le biais de l’origine animale du coronavirus que tu t’es intéressé à la question ?
Marius : Tout à fait.
Claude : Et comment as-tu été appelé dans le panel d’experts qui conseillait le gouvernement ?
Marius : Ca, c’est encore différent. J’ai petit à petit occupé une place médiatique importante. J’étais invité sur les plateaux télé pour faire de la pédagogie et répondre aux questions des gens.
J’avais bien sûr une légitimité scientifique, basée sur mes publications, mais ce sont les médias qui m’ont intronisé expert en coronavirus.
Et cela a incontestablement joué dans le fait que je sois choisi dans ce groupe d’experts.

Claude : On a vu qu’il ne suffisait pas d’être expert ou médecin pour avoir une vision commune de la maladie et de son traitement.
En France, il y a eu des polémiques très violentes qui ont impliqué des virologues, des médecins, d’anciens ministres de la santé, autour, par exemple, de l’usage la chloroquine ou l’azithromycine…
Les débats ont-ils été aussi clivés et tendus entre vous, ou bien y avait-il un consensus autour des mesures sanitaires à prendre ?
Marius : Au sein même du groupe d’experts, il n’y avait pas de grosses divergences. Par contre, à l’extérieur, il y avait parfois des lectures contradictoires. Mais c’est normal, ces divergences font parties de la démarche scientifique, surtout vis-à-vis d’une maladie dont on ne connaissait encore rien.
Des débats contradictoires, c’est intrinsèque à la démarche scientifique. Après, il y a des protocoles expérimentaux, des démarches bien établies, et largement acceptées, pour déterminer si une molécule est efficace ou pas.
Tout ça est très codifié, pour éviter que l’effet obtenu soit le fait du hasard, ou soit liée à « l’effet placebo » (1).
Ce que je retiens de cette polémique, c’est que face à un problème complexe, une solution « simple » est toujours infiniment plus facile à vendre.
C’est plus audible sur les réseaux sociaux, de dire : « on a trouvé un médicament ou un traitement miracle, mais on veut vous le cacher », que de dire « on est tous le nez sur le guidon, c’est compliqué et on cherche ».
Face aux problèmes complexes, les porteurs de « solutions simples » ont toujours un tapis rouge devant eux.
Au niveau belge, de façon très empirique, plusieurs hôpitaux belges, très tôt à St Pierre, ont testé la chloroquine, et comme ça ne marchait pas vraiment, ils se sont tournés vers d’autres médicaments.
On est resté très pragmatique, sans rentrer dans la polémique franco-française.
Claude : J’ai quand même été assez étonné, au mois de mars, de la rapidité avec laquelle le confinement général a été décidé par le gouvernement.
Mettre tout un pays à l’arrêt, ce n’est pas rien, et le gouvernement a fortement mis les experts « en avant » pour justifier sa décision.
Marius : Il faut préciser quelques chose, moi je ne suis rentré dans le groupe d’expert que plus tard, au mois d’avril. Ce n’est pas pour me défausser, mais simplement, je n’étais pas là.
J’étais extérieur à la décision, mais quand elle est assumée, la relation entre le gouvernement et les experts me semble assez saine. Et ce qui se passait en Italie nous lançait de graves signaux d’alerte.
Moi j’ai toujours insisté sur la transparence, parce que cela pose un problème démocratique. Il n’était pas du tout clair de savoir comment ces décisions étaient prises. Je trouve que c’est un des rendez-vous manqués de cette épidémie.
Les décisions ont toujours été très verticales, de haut en bas, avec un gouvernement qui décidait des mesures parfois très lourdes, avec quelques experts triés sur le volet, choisis on ne sait pas très bien sur quelle base, et qui écrivaient des rapports qui n’étaient pas directement publics.
Il y a eu une opportunité manquée.
Alors que certaines décisions auraient nécessité un débat plus ouvert, parce que d’autres choix étaient légitimes.
Parfois, il a plusieurs solutions qui s’offrent.
On a un certain « capital de transmission », pour garder le contrôle de l’épidémie, et on peut choisir où on le met.
Par exemple, tu es bien placé pour le savoir, il y a un moment où on a décidé que la culture viendrait en dernier.
Mais ça, ce ne sont pas des positions d’experts, ce sont des choix politiques, et qui doivent être assumés en tant que tels.

Claude : Tu parles de transparence. Y a-t-il vraiment des études scientifiques qui ont déterminé les lieux où le virus se propage et ses modes de transmission privilégiés ?
Marius : On peut établir des protocoles « corona-safe » pour certaines activités, mais on sait très bien que dans un café ou un restaurant, comme les gens ôtent leur masque pour boire et manger, et comme il parlent un peu plus fort et postillonnent pour se faire entendre, et que la maladie se transmet par aérosol… ce sont potentiellement des lieux de contagion, surtout en hiver, quand les locaux sont clos et peu ventilés. Mais cela reste une déduction, parce qu’il n’existe pas de réelle cartographie des lieux de « clusters ».
A quelques exceptions près, le système de « tracing » n’a jamais servi à ça.
C’est une mesure qui a été prise en se disant « ça donne la possibilité de… », mais elle n’a jamais été réellement utilisée à grande échelle.
Claude : C’est curieux, parce que le boulot administratif qu’on a demandé à l’Horeca, avec ces fiches à remplir et à conserver pour chaque client, c’était quand même du très lourd…
Marius : Je sais bien, il y a eu des tas de contradictions dans la gestion de cette crise, et celle-là en a été une de taille. En fait, quand les gens restent longtemps ensemble au même endroit, comme dans une entreprise, un home ou une école, c’est plus facile de déceler un « cluster ».
Mais pour tous les lieux de passage, là où les gens ne restent pas, comme les cafés, les restaurants, les mariages, les salles de spectacle, les transports en commun… on n’a jamais été en capacité de les identifier comme lieux de transmission.
Ca ne veut pas dire qu’ils ne l’étaient pas.
Mais on n’a pas pu les cibler, les lister et les nommer.
On manquait de données empiriques.
Bon, aujourd’hui ces données existent dans d’autres pays, il y a par exemple une grosse étude aux Etats-Unis qui cible clairement les cafés et les restaurants comme lieux de transmission, et d’autres études qui sont venues conforter la thèse de la transmission de la maladie par aérosol, mais au début, les recommandations des experts étaient basées sur des approches essentiellement déductives.
Claude : J’avais été surpris, en France, que plusieurs abattoirs aient été clairement identifiés comme des « clusters ». Je m’étais dit que c’était probablement lié à la chaîne du froid…
Marius : Tout à fait. Mais ça, ce n’est pas nouveau. Dans les frigos, la respiration se fige en buée, et reste en suspension dans l’air. Et les systèmes de ventilation fonctionnent en circuit fermé, pour garder le froid à l’intérieur.
Claude : Est-ce qu’il n’y a pas là une contradiction avec la recommandation qui a été faite d’aérer les locaux ? En été, on peut ouvrir la fenêtre. Mais en hiver ?
Marius : Oui, quand on parle de ventiler les locaux, il faut absolument qu’il y ait une captation de l’air extérieure et renouvellement de l’air ambiant. Sinon, au lieu de résoudre le problème, on l’aggrave. Sauf pour les systèmes équipés de filtres, comme dans les avions.
Claude : Compte tenu de l’état de nos connaissances au début de l’épidémie, il n’y avait probablement pas d’autres choix à faire que ceux qui ont été opérés.
Mais est-ce qu’on n’a pas sous-estimé les dégâts collatéraux du confinement, notamment en terme de santé mentale ?
Pour les personnes isolées, ou pour les vieilles personnes privées de leur famille, cela a été terrible. Chez certain·es, cela a même été un accélérateur de mortalité.
Etre privé de ses proches, dans ces moments de passage entre la vie et la mort, cela nous enlève une partie de notre humanité.
En s’occupant uniquement du virus, est-ce qu’il ne manquait pas, parmi les experts, de spécialistes des sciences sociales qui auraient pu intervenir dans ce débat ?
Marius : On s’est tout de suite inquiété, au début des travaux du GEES, de n’avoir aucun expert en santé mentale. On l’a dit une fois, deux fois, puis on a commencé à bosser avec ce qu’on avait. C’est effectivement quelque chose qui n’a pas assez été pris en compte.
Mais pas uniquement pour des raisons de santé mentale.
Comme le COVID-19 est un virus, on croit que les solutions sont d’abord d’ordre biomédicales.
Or le paradoxe, c’est que la solution principale pour lutter contre la maladie, elle vient d’abord de la société, des comportements des gens.
Mais dans le groupe d’experts, on n’avait que des personnes qui s’occupent des virus, pas de psychologie ou de sciences sociales.
Comment faire en sorte que la population puisse adhérer à des mesures sanitaires ?
C’est une question toute simple, mais si on ne se la pose pas, on va à l’échec.
Si on demande aux gens de changer leurs comportements privés, on est pourtant totalement tributaire de leur adhésion ou pas aux consignes.
Mais je suis d’accord avec ta remarque.
On s’est concentré sur la santé physique, alors que pour les personnes fragiles, le physique et le mental vont vraiment ensemble.
Par exemple, comme observateur, ce qui m’a frappé, c’est l’événement de surmortalité de la canicule de cet été.
Claude : Oui, j’ai vu cela dans les courbes.
Marius : Tu as eu le sentiment qu’il a fait particulièrement caniculaire cet été, toi ?
Claude : Non, effectivement.
Marius : On a un pourtant là un événement statistiquement très marquant, en terme de mortalité, qu’on n’avait pas les autres années.
C’est bien sûr la conséquence directe d’une déshydratation, mais je pense… c’est une hypothèse, hein… que c’était probablement aussi lié aux mesures d’isolement, à une faiblesse psychique, et au fait que le COVID polarisait toute l’attention des soignants.
Claude : Il y a un autre élément qui rend la maladie difficile à appréhender par la société, c’est le nombre très important d’asymptomatiques, de ceux et de celles qui rencontrent le virus sans développer les symptômes de la maladie, alors que pour d’autres, elle est dangereuse ou mortelle. Ce qui a nourri tous ces discours qui courent sur les réseaux sociaux, qui parlent d’une maladie imaginaire, d’une maladie « inventée », qui ne concernerait « que les vieux », etc…
Marius : Moi-même, j’ai été testé positif avec ma compagne en octobre. Pendant deux jours, je ne me suis pas senti bien, un peu comme une gueule de bois, et puis c’était fini. « Une allergie à l’alcool », pour reprendre le titre d’une de tes chansons (sourire).
On peut comprendre que ces gens-là soient très sensibles au discours : « On vous raconte des salades ».
Tant que tu n’as pas ressenti la douleur dans ton propre corps, tant qu’un de tes proches n’a pas été hospitalisé, tu ne perçois pas la dangerosité du virus.
C’est d’ailleurs un des gros problèmes de la prévention, on l’a bien vu cet été. Dès que les choses vont mieux, on réentend les discours qui discréditent les mesures sanitaires : « c’est fini… ça ne sert à rien… pourquoi on nous emmerde encore ? ».
C’est le paradoxe de la prévention : quand les mesures fonctionnent, elles ont l’air inutiles.
Mais si on les arrête trop tôt, l’épidémie repart. C’est ce qui est arrivé dans plusieurs pays d’Europe.
Pendant des mois, on nous a bassiné avec la Suède, « ils n’ont pas fait de lockdown… ils ont tout compris… ils ont responsabilisé les gens, ici on les infantilise… », et aujourd’hui, ils se prennent une vague dans la figure et tous les hôpitaux de Stockholm sont saturés…
En Suède, la structure sociale est différente, c’est surtout cela qui avait retardé l’épidémie.
La densité de population est moins grande, il y a plus de personnes qui vivent seules (donc moins de contamination interfamiliale), les structures de contacts sociaux sont moins importantes, comme en Allemagne (les gens vont voir « moins de gens » de différentes classes d’âge),…
Mais je suis d’accord, ce caractère « asymptomatique », surtout s’il se décline le long d’un gradieant d’âge, est particulièrement pervers.
C’est très clivant pour une société.
Puisqu’en fait, il faut qu’une partie de la population qui n’est absolument pas concernée par la maladie (en gros, « les jeunes »), accepte de subir des mesures extrêmement contraignantes sur leur vie quotidienne, pour sauvegarder les personnes plus âgées.
Et ça, c’est un vrai défi en terme de cohésion sociale.
Quand c’est juste pour quelques semaines d’épidémie, OK, tout le monde se met à la fenêtre et applaudit.
Lorsqu’il faut tenir dans la durée, et que cela a un impact sur la santé mentale des jeunes, c’est beaucoup plus compliqué. Je suis impliqué comme vice-recteur à l’ULB, les décrochages des jeunes sont très importants, liés à l’isolement, au manque de perspectives…
Déjà que ce n’était pas tout rose avant, avec le réchauffement climatique et tout ça… Maintenant, ils doivent en plus s’empêcher de vivre pour « sauver » leurs aînés….
Ce virus met le doigt à un endroit où ça fait très mal.
Mais bon, cela aurait pu être l’inverse… Une maladie qui ne frapperait que les jeunes et les enfants…
Cela nous oblige à reconsidérer ce qui fait société.

Claude : Est-ce que paradoxalement, l’asymptomatisme n’aurait pas pu ouvrir des pistes thérapeutiques ? Si on arrive à comprendre pourquoi certains sont malades et d’autres pas, et si cette caractéristique est transmissible, cela ne pourrait-il pas avoir une fonction curative ?
Bon, on sait bien sûr que l’âge est un critère déterminant, un phénomène d’usure du système circulatoire ou immunitaire, comme dans les maladies cardio-vasculaires…
Marius : On ne sait pas encore grand-chose à ce sujet. Les jeunes enfants ont un système immunitaire très réactif. Chez les personnes qui développent les formes sévères de la maladie, il y a un fort phénomène inflammatoire, provoqué par le virus, une surréaction du système immunitaire, qui ne s’observe que chez les personnes plus âgées.
Mais en toute franchise, cela sort un peu de mon domaine de compétences.
Claude : La séquence qui s’ouvre devant nous est clairement celle du vaccin. Le gouvernement belge en a même fait des préachats avant même que le vaccin n’existe, ce qui est une procédure curieuse pour l’attribution d’un marché public.
Marius : On a collectivisé la prise de risque par rapport au développement du vaccin. Il y a eu des investissements publics massifs.
Ce qui est assez peu connu, c’est que les Etats-Unis ont paradoxalement été leader dans ce domaine-là.
Claude : En quoi la recherche aux USA a-t-elle pu influencer les vaccins russes, chinois ou même européens ?
Marius : Chaque vaccin bien sûr a une histoire différente.
Différents facteurs ont joué pour expliquer la rapidité de mise sur le marché de certains vaccins.
D’abord, le COVID-19 est un cousin du SARS-COV-1, autour duquel il existait déjà tout un corpus d’expérimentations.
Deuxièmement, la virologie a fait d’énormes progrès dans le développement des vaccins à ARN-messager, qui préexistaient au COVID-19.
Troisièmement, il y a une armée de chercheurs qui s’est aussitôt mise en route dans tous les pays du monde, avec la mobilisation de tous les laboratoires et d’énormes investissements publics.
Et enfin, on a la « chance » que ce soit un virus assez « simple », sur lequel on arrive à une assez bonne réaction immunitaire « classique », avec des méthodes de fabrication que l’on maîtrise relativement bien.
Et puis, comme il y avait urgence, on a accéléré les essais cliniques.
Claude : D’après ce que j’ai lu, d’une firme à l’autre, le prix d’une dose de vaccin pourrait varier de quelques euros à quelques centaines d’euros. Comment expliquer une telle différence ?
Marius : C’est une bonne question, mais elle est en dehors de mon domaine de compétences.
Claude : Et quand les vaccins seront tous mis sur le marché, pourra-t-on choisir, avec son médecin, « son » vaccin, où devra-t-on obligatoirement utiliser celui que le gouvernement a massivement précommandé ? Y a-t-il déjà des réponses à cela ?
Marius : Pas à ma connaissance. Mais c’est, de toutes façons, difficile de mettre sur pied une stratégie vaccinale tant que les caractéristiques de ces différents vaccins ne sont pas connues.
Claude : Tu sais sans doute qu’il existe un mouvement, « l’Agora des Habitants de la Terre », dont mon ami Pietro Pizzuti est un des relais en Belgique, qui milite pour que vaccin du COVID-19 et les médicaments qui le soignent deviennent un bien commun de l’humanité, pour que tous ceux qui en ont besoin puissent y accéder.
Comme on l’a vu récemment dans le film « 120 battements », sur la naissance du mouvement ACT-UP !, la mise à disposition de ces vaccins et de ces nouvelles molécules va rapidement devenir un enjeu politique.
Marius : C’est une initiative très intéressante, qui concerne aussi l’accès des pays pauvres aux médicaments, mais qui devrait s’adresser directement à l’OMS. Elle touche aussi à des questions fondamentales comme le rôle des entreprises privées en matière de santé, ou le rôle des partenariats public-privé.
Je pense toutefois que se priver complètement de l’innovation privée serait aussi un risque.
Parce qu’on voit, avec cette pandémie, que le partenariat public-privé a fonctionné… mais grâce à un investissement massif du public.
Dans la négociation sur les prix, il faudra que l’apport de chacun soit prix en compte. Et puis, même si on nationalise les vaccins, c’est le privé qui a aujourd’hui la capacité industrielle et technique de les produire.
Mais d’autres personnes que moi ont vraiment travaillé sur ces questions-là, notamment autour des molécules pour combattre le SIDA, et si le sujet vous intéresse, car c’est un très bon sujet, c’est avec eux qu’il faudrait je crois approfondir la question.

Claude : Tu connais certainement les théories, parfois très farfelues, qui ont couru sur les réseaux sociaux sur l’origine du COVID-19. Pour la petite histoire, tu as vu le film « Hold-up » ?
Marius : Non, je n’ai pas eu la patience, je me suis dit que j’allais m’énerver. C’est comme si tu t’infligeais la vidéo de quelqu’un qui t’insulte pendant deux heures. C’est une espèce de déni complet de toute la démarche scientifique et de ceux qui l’incarnent.
Mais ce qui est intéressant, c’est d’aller au delà de cela, et de se demander pourquoi tant de gens sont sensibles à ce genre de discours ? Ce que cela raconte sur la société et sur la science.
J’avais écrit un papier sur la vaccination pour la Revue Nouvelle, il y a quelques années, qui soulignait le fait qu’on payait peut-être aussi le prix de certains errements de la science.
Parce qu’il y a eu des cas avérés de conflits d’intérêts patents chez des gens qui conseillaient par exemple tel médicament au sein de groupes d’experts et cela jette évidemment la suspicion sur tout un système.
Et j’y suis confronté en plein dans mon rôle de vice-recteur à la Recherche et à la Valorisation à l’ULB, car derrière ce second terme, il y a toute la recherche de contrats « privé/public » pour financer les labos.
Depuis plus de vingt ans, on demande aux Universités de jouer un rôle de relais entre la recherche et le développement économique.
Ce n’est pas un mal en soi, mais cela place d’emblée un certain nombre de chercheurs dans une position délicate.
Si tu es malhonnête, qu’est-ce qui t’empêcherait de céder à la tentation de manipuler les résultats pour augmenter les actions de la start-up dans laquelle tu as des parts ? Les scientifiques travaillent honnêtement, il y a des garde-fous, et ça ne tiendrait de toutes façons pas dans la durée, parce qu’un des principes de base de la science, c’est que des résultats soient répétés par d’autres. Bref, ça finira toujours par se savoir, mais la question est réelle.
Claude : Tu es l’un de ceux qui, dans toute cette histoire, a su préserver la crédibilité de sa parole et sa confiance auprès du public. A quelques jours de Noël, autour d’une fête qui fait polémique, qu’aurais-tu envie de faire passer comme message auprès des gens ?
Marius: Je pense que cela peut se résumer en une phrase.
On n’a pas envie d’avoir un siège vide l’année prochaine parce qu’on a eu une table bien remplie cette fois-ci.
Il y a un vrai risque, si on ne fait pas gaffe, que l’épidémie rebondisse.
Et ce n’est pas le problème d’un seul repas. On sait qu’il y a des tas d’activités autour de la période de Noël, des visites familiales, des « pots » au travail, des magasins bondés, et une semaine après, juste la période de l’incubation, paf !, rebelotte avec les Fêtes du Nouvel An.
C’est toute la séquence qui pose problème.Là où cela reste très dur, c’est pour les personnes isolées.
C’est pourquoi, je pense que le gouvernement devrait travailler plus, je crois, sur toutes les mesures d’accompagnement, sur tous les aspects compensatoires. Pour aider les gens à passer ce cap difficile.
Ce qu’il faut se dire, c’est qu’on a de très très bon résultats du côté des vaccins, et que c’est probablement le dernier Noël que nous passons comme ça. Qu’il n’y en aura pas un autre.
Parce que quand le vaccin protègera les personnes vulnérables, on n’aura plus cette surmortalité inquiétante, et on pourra revivre plus « normalement », avec une létalité « acceptable », qui selon l’efficacité et l’acceptation du vaccin, pourrait devenir comparable à celle de la grippe.
Et ça, ce n’est pas dans cinq ans, ce n’est pas dans trois ans, c’est dans quelques mois.
Sachant cela, est-ce qu’on ne peut pas se dire : « Ce sera un Noël comme ça, un Noël un peu particulier » ?
Encore quelques mois de patience.
Après tout, à Noël, on fête une naissance, on fête la vie.
Faisons en sorte que ce soit vraiment le cas.
Interview et retranscription par Claude Semal le 14 et le 15 décembre 2020
Pour terminer en musique, deux chansons : l’une sur les virus (“Eros Positif“, CD “Music-hall” / Igloo Records), l’autre interprétée par le GAM (Groupe d’Action Musical) (“Allez les gars !“, 33T du Gam ).



Jacques DAL
Publié à 17:54h, 26 décembreTrès bonne interview en toute transparence…
Cependant, à travers la gestion de la crise, je pense qu’il y a deux aspects de notre société qui sont complètement éludés.
Le premier est le rapport à l’acceptation de la mort comme élément de la vie. On meurt de vivre, pas de maladie…
Le second est le risque zéro, la volonté de l’homme de vouloir tout contrôler à tout prix et le refus de l’acceptation et de l’accueil de ce qui se présente.
Des ces deux éléments, les dirigeants ont préféré sacrifié une grosse partie de la population.
En 1348, la peste noire tuait 1 habitant sur 2 en Europe. 2 ans plus tard, la Renaissance débutait…
N’en est-on pas là, à la fin d’un système, d’un modèle de civilisation notamment par l’importance du secteur privé dans le bien-être de la population?
Si Marius GILBERT peut donner son avis, ce serait sympa 🙂
Chantal Terryn
Publié à 22:31h, 21 décembreQuel plaisir que la lecture de cet interview, ouvert, non partisan, fouillé,, intelligent…..je regrette pas mon abonnement, et merci à ma niêce de m’avoir refilé lla référence du site d’asymptomatique.be…….bonne route à vous!
Colette Sancy
Publié à 08:22h, 21 décembreLes chiens ne font pas des chats ! Je me souviens de m’être creusé la tête dès qu’on a vu la binette de Marius à la TV… J’ai vite retrouvé trace du père (Roudoudou) avec qui j’avais chanté à l’époque…mais la mère ? Jacqueline ? Non pas Jacqueline… Ses yeux me rappelaient quelqu’un… Au bout de quelques jours, ça m’est revenu, Une charmante personne, Perrine, sociologue, je pense qui m’avait interrogée pour une étude de santé publique du temps où je tenais bénévolement l’accueil à la Maison Médicale “Norman Bethune” (quand je vous disais que les chiens ne font pas des chats ! ) Je l’ai retrouvée quelques années plus tard avec beaucoup de plaisir comme compagne d’un de mes grand amis le réalisateur palestinien Michel Kleiffi . Donc, pour répondre à l’intervenante précédente, et avec toute la grande amitié que je porte à Roudodudou, je pense qu’ici la place de la mère dans cette filiation professionnelle est prépondérante ! Salutations fraternelles à tous les acteurs de cette belle saga familiale !
colette decuyper
Publié à 18:35h, 17 décembremerci beaucoup pour cet entretien très intéressant, où on laisse la place nécessaire à la parole de l’autre, et où les questions sont pertinentes et ouvertes – contente de m’être abonnée : continuez, et merci !
Michèle Loijens
Publié à 15:40h, 17 décembrej’ai adoré cette interview qui sort un peu des sentiers habituels des ‘interview” et c’est très bien ainsi, continuez ainsi à l’asymptomatique c’est ce que j’attends de ce type de média
François-Michel van der Rest
Publié à 12:33h, 16 décembreMerci, Klod, et bravo ! Une discussion ouverte où la passion est d’accoucher d’une relative vérité et non d’avoir raison absolument, ça me ravit.
Et quand il suggère d’avoir ce genre de discussion avec un représentant des producteurs de vaccin, “L’asymptomatique” va-t-il donner suite ? Marius Gilbert t’a-t-il donné une piste ?
Semal
Publié à 13:26h, 16 décembreMerc François-Michel. Je vais me relire, mais je n’ai pas compris la même chose que toi ;-). Je pense que Marius nous orientait plutôt vers les gens qui se sont battus pour un accès des pays pauvres aux vaccins et aux molécules, sur le modèle d’ACT-UP et des traitements su SIDA. Je ne suis pas sûr que ce soient les producteurs du vaccin eux-mêmes. Je pense même qu’il s’agit d’autres personnes, avec d’autres priorités ;-). Bises, Klod
Catherine Kestelyn
Publié à 11:30h, 16 décembrePeut-être suis-je “people”, mais Roudoudou, il a fait Marius tout seul? C’est vrai qu’il a toujours été légèrement enveloppé: donc, qui sait, le foetus se logeait entre deux poignées d’amour?
Semal
Publié à 13:20h, 16 décembreEuh… Je ne connais pas la maman de Marius. Quand nous nous sommes connus, Roudoudou habitait avec Jacqueline, mais je ne pense pas que cele te ou nous regarde. Maintenant, si une étude généalogique de Marius Gilbert t’intéresse, n’hésite pas à nous documenter sur le sujet ;-).
Catherine Kestelyn
Publié à 13:40h, 16 décembreJe ne voulais pas connaître à toute force la vie sentimentale de Roudoudou. Peut-être, oui, je pinaille. Je n’aime pas qu’on invibilise les mères.