
25 mai 2021
Dibbouks au Guinness Book
Notre collègue et amie Irène Kaufer vient de sortir un livre, « Dibbouks », qui lui a valu ce week-end une double page dans « Libé ».
Elle vous en a déjà parlé, avec sa modestie proverbiale, mais cela vaut quand même bien une petite couverture dans l’Asympto !
Dans la croyance populaire juive, le « dibbouk » (à ne pas confondre avec le face-di-book, plus commun et moins littéraire) est l’âme d’un mort qui vient s’incarner dans le corps d’un vivant. En l’occurrence, une demi-sœur que le père d’Irène, rescapé de la Shoah, a perdu pendant la guerre 40-45 en même temps que sa première femme.
Entre Bruxelles, la Pologne et Montréal, par la grâce de la magie romanesque, la narratrice va retrouver sa trace à l’autre bout du monde. Est-ce bien elle, cette vieille dame qui étale du sirop d’érable sur ses pancakes ?
Avec une émotion teintée d’ironie, Irène nous prend par la main pour nous conduire dans les tragiques failles temporelles de la petite et de la grande histoire. L’humour juif est l’enfant naturel des pogroms.
Propos recueillis par Claude Semal le 20 mai 2021.
(Nota Bene : Nous n’avons pas du tout abordé, dans cet entretien, l’actualité et la situation politique et militaire en Israël. Ce n’était pas le sujet, et je ne pense pas opportun de sommer chaque “juif” d’en permanence commenter l’actualité d’un pays qui n’est pas le sien. Sachez simplement qu’Irène s’est activement impliquée chez nous, comme d’autres juifs progressistes, dans le dialogue permanent entre la communauté arabo-musulmane et les autres composantes de la société belge).
Claude : Il paraît qu’on écrit toujours le même livre. Dans « Fausses Pistes » (Ed. Luc Pire), tu cherchais un ancien collaborateur de « POUR », l’hebdo « révolutionnaire » auquel nous avons collaboré à la fin des années ’70. Dans « Dibbouks », tu pars à la recherche de ta sœur…
Irène : Tu veux dire que je suis toujours en train de chercher quelqu’un ? (rires)
Claude : … et la « grande » histoire rejoint ici la petite, puisque tu cherches une petite fille que ton père a perdue dans l’holocauste en même temps que sa première femme. Qu’est-ce qui t’a donné envie de revenir sur cette histoire aujourd’hui ?
 Irène : Au départ, il y a le témoignage vidéo de mes parents pour la Fondation Spielberg, qui avait eu la bonne idée de collecter à la fin des années ’90 les témoignages des derniers témoins vivants de la Shoah. Mes parents n’étaient pas très chauds pour témoigner, mais moi j’y tenais absolument. Je savais que mon père avait perdu une petite fille et sa femme pendant la guerre, mais c’était un sujet tabou dont il ne parlait jamais. Ma mère me disait : « C’est trop douloureux pour lui », et je comprenais très bien. Un jour, j’ai au moins eu besoin de savoir comment ma demi-soeur s’appelait. Mon père me l’a dit, et nous avons commencé à en parler. C’était vers la fin de sa vie.
Irène : Au départ, il y a le témoignage vidéo de mes parents pour la Fondation Spielberg, qui avait eu la bonne idée de collecter à la fin des années ’90 les témoignages des derniers témoins vivants de la Shoah. Mes parents n’étaient pas très chauds pour témoigner, mais moi j’y tenais absolument. Je savais que mon père avait perdu une petite fille et sa femme pendant la guerre, mais c’était un sujet tabou dont il ne parlait jamais. Ma mère me disait : « C’est trop douloureux pour lui », et je comprenais très bien. Un jour, j’ai au moins eu besoin de savoir comment ma demi-soeur s’appelait. Mon père me l’a dit, et nous avons commencé à en parler. C’était vers la fin de sa vie.
J’ai voulu faire quelque chose avec ce témoignage, mais je ne savais pas vraiment quoi.
Pour moi, on ne peut pas faire de fiction sur la Shoah, et un documentaire, je ne m’en sentais pas les épaules. Mais j’ai imaginé une fiction sur la recherche cette sœur perdue, parce que toute ma vie, j’ai été hantée par le fait que si moi je suis en vie, c’est parce qu’elle est morte. Si elle avait survécu, mon père serait resté avec elle et sa femme, il n’aurait jamais rencontré ma mère, et je ne serais pas là pour le raconter. Il fallait que je la retrouve d’une certaine façon. La façon, cela a été d’écrire un livre.
Claude : Pour la petite histoire, ma mère s’appelait « Paulette » parce que ma grand-mère avait perdu en couches un bébé qui s’appelait « Paul ».
Irène : Annie Ernaux a écrit un beau livre là-dessus, qui n’est pas le plus connu, mais qui est très touchant : « L’autre fille ».
Claude : Comment s’invente-t-on une histoire et un destin personnels quand on hérite d’emblée du poids de ce destin collectif ?
Irène : C’est une bonne question (rires). Déjà, on a des parents particuliers, mais ils le sont peut-être tous. Il y a un livre tout récent, qui vient de sortir, qui s’appelle « Venir Après », de Danielle Laufer, qui est un recueil de témoignages d’enfants de survivants. J’ai retrouvé beaucoup de points communs avec mon propre vécu. De traumatisme transmis, mais aussi de culpabilité. C’est un mécanisme connu, on se dit : « Pourquoi moi ? », alors que tous les autres sont morts. Mon père disait toujours que s’il avait survécu, c’était uniquement une question de chance. Il n’avait rien fait de particulier ou d’admirable, ni d’ailleurs des choses horribles, parce qu’il y a des gens qui ont survécu en volant le pain des autres, ou en se mettant au service des bourreaux.
Ma mère, elle a survécu avec les papiers d’une Polonaise décédée, en se portant volontaire pour aller travailler en Allemagne dans un restaurant…
Claude :… dans la gueule du loup !
Irène : … Parce que c’est là qu’elle était le plus en sécurité. Elle a survécu trois ans comme ça, en se disant que les Allemands ne se douteraient jamais qu’elle était juive, parce qu’en Pologne, elle avait toujours peur que quelqu’un la reconnaisse dans la rue. Mais j’imagine ce qui doit se passer dans sa tête, alors que toute sa famille a disparu. Il y a cette culpabilité de « survivant » que l’on transmet à ses enfants. On se demande si l’on est légitime, si l’on a le droit d’exister. On se sent aussi investi du rôle de protéger ses parents, alors qu’en principe, c’est plutôt l’inverse. A l’école primaire, j’avais été victime de harcèlement, et des enfants avaient cassé mes lunettes ; mais j’ai préféré m’accuser moi-même de négligence, et être punie pour cela, plutôt que de leur causer du souci.
Claude : Il y a un film de Jaco Van Dormael, « Mister Nobody », qui est construit sur la multiplicité des destins possibles. C’est une des grilles de lecture de ton livre, les personnages sont sur la ligne des eaux, et puis leur destin bascule vers des vies fort différentes.
Irène : C’est le seul film de lui que je n’ai pas vu. Il y a aussi le film de Krzysztof Kieślowski , « Le Hasard », qui raconte les vies d’un jeune homme selon qu’il prenne ou rate un train. C’est fascinant.
Une fois que j’ai moi-même commencé à raconter ces autres vies « divergentes », il fallait évidemment pouvoir les imaginer. J’ai imaginé que ma demi-sœur habitait Montréal, j’ai été y vivre cinq semaines, et j’ai nourri mon livre des vraies rencontres que j’ai faites là-bas. L’Exposition « Shalom Montréal », je l’ai vraiment visitée. Mais je ne savais pas qu’elle y était programmée, je suis juste partie au hasard avec un carnet de notes.
Toute cette fiction a d’ailleurs une origine concrète. Quand nous avons quitté la Pologne pour Israël, où nous avons vécu un an et demi, cela ne s’est pas très bien passé, et en ensuite, mes parents ont voulu immigrer au Canada… pour finalement s’arrêter à Anvers. Donc, quelque part, le Québec faisait déjà partie de l’imaginaire familial. En plus, j’adore Montréal, où j’ai séjourné à plusieurs reprises. C’est la ville où j’aimerais vivre si je n’habitais pas Bruxelles. J’y ai donc domicilié ma demi-sœur littéraire.
Claude : Est-ce que l’écriture de ce livre a changé ton rapport à la judéité ? On voit parfois des trucs étrange : Benny Levy, alias « Victor », l’ancien chef de la Gauche Prolétarienne en France, a terminé sa vie en exégète de la Torah… Tu vas me dire, pour un ancien « stal », retourner au catéchisme, ne n’est pas vraiment étonnant… (rires) (NDLR : Staline a été séminariste).
 Irène : Ce qui est étrange pour moi, c’est que je n’ai jamais vraiment eu de lien avec la communauté juive, non que j’ai rompue avec elle, simplement, je n’en ai jamais fait partie. J’ai quitté Anvers à 18 ans, mes parents n’étaient pas religieux, je fréquente plutôt les milieux athées… Ce retour au judaïsme, ou à la religion, cela ne m’a jamais rien dit du tout.
Irène : Ce qui est étrange pour moi, c’est que je n’ai jamais vraiment eu de lien avec la communauté juive, non que j’ai rompue avec elle, simplement, je n’en ai jamais fait partie. J’ai quitté Anvers à 18 ans, mes parents n’étaient pas religieux, je fréquente plutôt les milieux athées… Ce retour au judaïsme, ou à la religion, cela ne m’a jamais rien dit du tout.
Mais en relisant le livre, et en en parlant avec des milieux juifs, parce ce qu’évidemment ce sont les premiers à avoir réagi à cette histoire, la maison de la culture yiddish à Paris, la maison de la culture juive à Bruxelles, pour te dire, j’ai découvert son existence à cette occasion ! … Je me suis rendu compte que je ne parle finalement dans ce livre QUE du judaïsme et de la famille, deux sujets qui, jusqu’ici, m’étaient tout-à-fait étrangers. A part une cousine à Londres, je n’ai plus aucun contact avec ma famille « de sang », dont une partie vit aujourd’hui en Israël. Ma famille à moi, c’est une famille choisie, ce sont mes ami.es. Je ne suis pas du tout « famille », et pas du tout « judaïsme », et il se fait que le bouquin, il ne parle que de ça !
La religion, cela ne m’a jamais intéressée, mais la culture juive, c’est quelque chose que mes parents m’ont transmis. Trois choses me relient très fort au fait d’être juive, même si, pour le reste, je m’en suis totalement détachée. La Shoah, bien sûr. La musique : quand j’écoute de la musique klezmer, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et l’humour. Je connais une blague juive pour toutes les circonstances de la vie !
Claude : Il y a une chose sur laquelle tu ne dois pas revenir, car tu ne l’as jamais quittée, c’est le féminisme. Qu’est-ce que tu penses de son renouveau actuel, que ce soit sous l’étiquette « Metoo », ou dans un mouvement comme F(s) dans le domaine culturel ?
Irène : A part mon père, pratiquement tous les personnages de mon livre sont des femmes, ce qui est peut-être une façon inconsciente de souligner qu’ailleurs, les héros sont très majoritairement des hommes. Qu’il y a un renouveau du féminisme, cela me paraît assez évident. Et j’ai envie de dire : place aux jeunes ! Ce que je trouve très riche, c’est tout l’aspect intersectoriel, qu’on n’avait pas du tout dans les années ’70, c’était plutôt un féminisme petit-bourgeois et intellectuel, très peu sensible à la diversité, même si certaines de mes amies le nient. Autant on ne peut plus accepter qu’il n’y ait que des tribunes d’hommes dans les médias, autant on ne peut plus accepter non plus qu’il n’y ait que des tribunes de femmes blanches. Il faut absolument qu’il y ait plus de diversité dans le féminisme lui-même. Je crois que les jeunes féministes d’aujourd’hui y sont beaucoup plus attentives, et c’est un apport formidable.
Sur les question de genre ou trans, je suis parfois plus dubitative, mais je crois qu’il faut pouvoir entendre d’autres voix, même quand on ne les comprend pas, et de vieilles féministes comme moi doivent parfois apprendre à se taire et à accompagner le mouvement (rires).
 Je collabore aussi à « Axelle », et je constate dans mes chroniques que le mouvement « balance ton porc » commence vraiment à toucher tous les milieux, le sport, l’enseignement, là récemment, c’est « balance ton folklore », avec les « baptêmes étudiants » où les femmes se faisaient gravement humilier.
Je collabore aussi à « Axelle », et je constate dans mes chroniques que le mouvement « balance ton porc » commence vraiment à toucher tous les milieux, le sport, l’enseignement, là récemment, c’est « balance ton folklore », avec les « baptêmes étudiants » où les femmes se faisaient gravement humilier.
Puisque tu m’as posé la question sur F(s), je trouve par exemple génial d’avoir introduit un dossier collectif pour la direction du Théâtre National, parce que cela renoue avec la dimension collective du combat féministe. Dans les premiers cahiers du « GRIF », par exemple, les articles n’étaient pas signés, parce que nous estimions qu’ils étaient le fruit d’une réflexion collective. Pour le moment, il y a deux féminismes qui se développent. Un féminisme institutionnel, qui insiste surtout sur les « femmes remarquables » qui « ont réussi » – pourquoi pas, car elles peuvent servir de modèles aux plus jeunes, et leur montrer qu’on peut devenir ce qu’on veut, générale, astronaute ou PDG… Mais ce n’est pas celui-là qui m’intéresse. Et puis un féminisme plus collectif, comme F(s) précisément, qui retrouve je crois les racines du féminisme, avec la diversité en plus. Donc moi, je suis assez enthousiaste.
Claude : 45 ans après « POUR » (…ce qui ne nous rajeunit pas !) nous nous retrouvons à nouveau dans la même rédaction d’un journal. A l’époque, nous avions l’ambition de formuler une « contre information » populaire par rapport à des médias qui appartenaient soit au capital, soit à l’État. De ce point de vue, la situation n’a pas vraiment changé.
Mais il me semble qu’en plus, aujourd’hui, la plupart des médias pratiquent une forme de « journalisme de guerre » contre le COVID-19, où il s’agit moins de questionner la réalité que de relayer les discutables directives gouvernementales. Ce qui relève plutôt de la propagande, et ouvre un espace aux médias alternatifs.
Irène : Avec nos modestes moyens, nous ne sommes pas dans une logique de « contre information », mais plutôt dans une logique de contre-point. Nous n’avons pas d’ambition « généraliste ». Nous faisons entendre d’autres sons de cloche. Nous donnons notre point de vue. Nous n’imposons pas une « contre-propagande » à une « propagande », nous ouvrons un espace où des débats restent possibles. Nous ne sommes pas nécessairement du même avis. Nous ne nous exprimons pas tous les quatre sur le même mode.
Luke est dans l’humour et le décalage. Moi, je donne plutôt mon avis, « j’éditorialise ». Toi, tu as une approche plus « journalistique ». Mais le tout me semble plus complémentaire que contradictoire.
Claude : Revenons à ton livre. Tu viens de faire deux pages dans « Libé », ce qui n’est pas courant pour une maison d’édition belge.
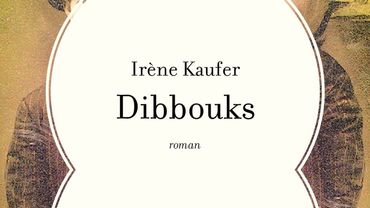 Irène : C’est une maison d’édition française, hein ? (sourire) Cette fois-ci, j’ai fait choix de « passer par Paris » avec ce livre-là. Je n’ai fait que trois envois, mais en tapant assez « haut ». Grasset a refusé tout de suite. Le second n’a jamais répondu. Et l’Antilope a dit « oui » après six mois. C’est un « petit » éditeur, ils n’éditent que cinq livres par an, mais ils font vraiment leur travail à fond. Ils ont fait un vrai boulot de relecture, en me faisant de nombreuses propositions, y compris de modifications, mais en me laissant toujours le dernier choix. Ça été vraiment un gros boulot, trois ans en tout. J’ai eu de nombreux « retours » de libraires, des « coups de cœur », dans des bleds, je ne sais même pas où ça se trouve, des avis de lectrices, de journalistes, c’est assez enthousiasmant.
Irène : C’est une maison d’édition française, hein ? (sourire) Cette fois-ci, j’ai fait choix de « passer par Paris » avec ce livre-là. Je n’ai fait que trois envois, mais en tapant assez « haut ». Grasset a refusé tout de suite. Le second n’a jamais répondu. Et l’Antilope a dit « oui » après six mois. C’est un « petit » éditeur, ils n’éditent que cinq livres par an, mais ils font vraiment leur travail à fond. Ils ont fait un vrai boulot de relecture, en me faisant de nombreuses propositions, y compris de modifications, mais en me laissant toujours le dernier choix. Ça été vraiment un gros boulot, trois ans en tout. J’ai eu de nombreux « retours » de libraires, des « coups de cœur », dans des bleds, je ne sais même pas où ça se trouve, des avis de lectrices, de journalistes, c’est assez enthousiasmant.
Claude : Ce long travail d’écriture a-t-il amorcé la pompe ? Tu as déjà un autre projet sur la table ?
Irène : Beaucoup de gens ont souligné que le livre était à la fois drôle et émouvant, comme l’a écrit la journaliste de « Libé ». L’humour, cela permet de parler de sujets graves sans que cela soit trop dur ou plombant. J’ai envie de continuer sur cette piste-là avec un projet très rigolo, « la vieillesse et la mort ».
(Claude éclate de rire).
Claude : Pour terminer précisément sur une note d’humour, tes amis et « followers » sur Facebook connaissent toutes l’histoire de ton père et du fameux « passage à l’heure d’été » (ou d’hiver…).
Irène : Oui, tous les six mois, c’est un grand succès, quand je l’oublie, on me le réclame !
A chaque passage d’heure d’été à l’heure d’hiver, ou l’inverse, mon père se levait à deux ou à trois heures du matin, c’est selon, pour modifier toutes les horloges et toutes les montres de la maison. Son gros problème, c’était le lecteur vidéo, qui passait automatiquement de l’heure d’été à l’heure d’hiver, mais qu’il s’obstinait à vouloir changer manuellement. Et qui avait donc toujours, incompréhensiblement, une heure de retard ou une heure d’avance.
« Dibbouks », d’Irène Kaufer, aux Editions de l’Antilope, chez tous les bon libraires.
Légende des photos : en haut, une capture d’écran du témoignage du père d’Irène pour la Fondation Spielberg ; en bas, Irène à la guitare chantant “le rock des femmes” dans une manif féministe à Liège à la fin des années ’70. Le jeune homme à l’accordéon, c’est Claude.



Catherine Vegairginsky
Publié à 18:41h, 30 maiTrès chouette cette interview!